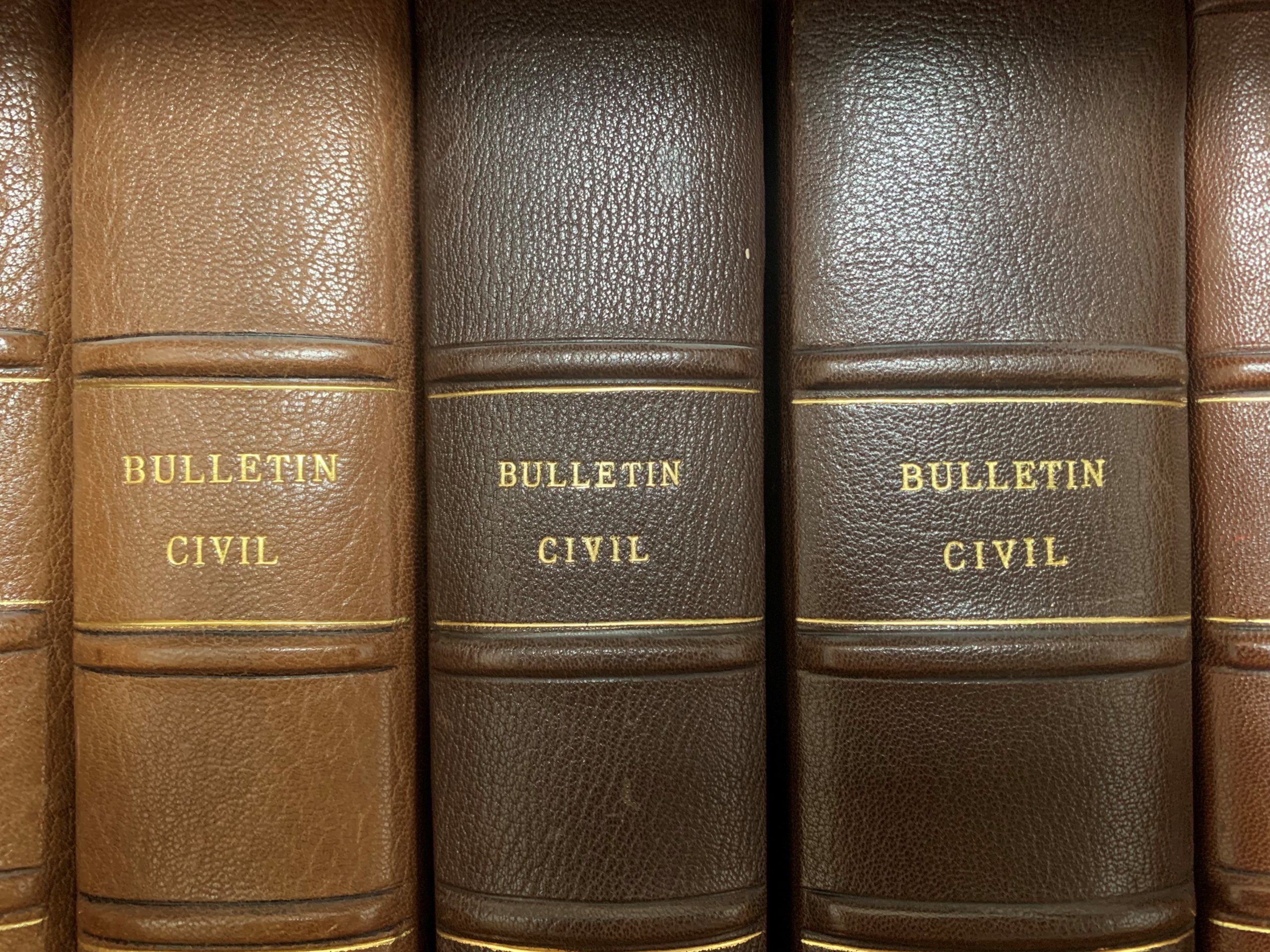Péremption d’instance, la fin d’un déni de justice : les parties ne sont pas responsables de l’inaction du juge
2ème civ., 11 septembre 2025, n°24-16.468
À l’occasion d’un contentieux relatif à la procédure d’appel – et plus spécifiquement aux rôles respectifs des parties et du conseiller de la mise en état en matière de péremption d’instance – la Cour de cassation a réaffirmé sa position sur la question, tout en précisant la portée de ses créations prétoriennes.
En l’espèce, le litige opposait deux particuliers à deux sociétés et a donné lieu à un jugement rendu par un tribunal de grande instance. L’une des parties a interjeté appel de cette décision.
Toutefois, le conseiller de la mise en état, par une ordonnance du 23 juin 2022 constaté la péremption de l’instance.
On le sait, en vertu des dispositions du Code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, en vertu du principe selon lequel les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent.
Pendant longtemps, la Cour de cassation considérait que la circonstance selon laquelle le conseiller de la mise en état n’ait fixé ni la date des plaidoiries ni la date de clôture de l’instance, n’engendrait aucune modification du délai de péremption, ce qui induisait l’obligation pour les parties de continuer à conduire la procédure, notamment en demandant la fixation de l’affaire.
A défaut, la péremption pouvait être constatée par ledit conseiller si le délai de 2 ans depuis les dernières diligences utiles était arrivé à son terme.
Une décision de 2016 illustre très bien cette position (2ème civ., 16 décembre 2016, 15-27.917 – https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033631168/).
La Cour a été encore plus loin en 2018 en considérant que même si une demande de clôture et de fixation avait été émise par une des parties, la péremption de l’instance pouvait quand même être prononcée, malgré la déclaration par l’appelante de sa volonté de ne plus conclure (2ème civ., 1er février 2018, 16-17.618 – https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036584836/).
Il s’agissait d’un véritable déni de justice qui imposait aux parties une double peine, d’une part elles voyaient les délais de jugement s’allonger déraisonnablement sans pouvoir agir et, d’autre part, elles étaient sanctionnées par une fin du procès sans qu’il ait été jugé.
C’est pour cette raison que le Cour de cassation a finalement opéré un revirement de jurisprudence en 2024 (2ème civ., 7 mars 2024, 21-19.475 – https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049321212).
En jugeant que la circonstance selon laquelle le conseiller de la mise en état n’ait pas fixé les dates de clôture de l’instruction et de plaidoiries ne prive pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l’affaire, et qu’il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise, la cour d’appel est allée à l’encontre de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, ce qui lui a valu la censure de sa décision.
L’autre intérêt procédural de l’arrêt rendu le 11 septembre dernier est qu’il ne s’agit pas d’une censure classique, puisqu’en l’état, la Cour de cassation ne casse pas l’arrêt de la cour d’appel mais l’annule.
Pour rappel, lorsqu’un arrêt ou un jugement est annulé sans être cassé par la Cour de cassation, cela signifie qu’au moment où la cour d’appel a statué, elle l’a fait conformément à l’état du droit applicable durant cette période, mais à l’encontre du droit au moment où la Cour de cassation a statué.
Ainsi, une annulation a pour objectif de trouver un équilibre entre la nécessité de juger conformément à l’état du droit en vigueur et celle de tempérer la sanction infligée aux juges du fond qui n’avaient commis aucune violation de la loi au moment où ils ont statués.
L’annulation était initialement prévue pour les situations où une loi nouvelle était adoptée et applicable aux instances en cours, au moment où l’une d’entre elles était pendante devant la Cour de cassation (Cour de cassation, Assemblée plénière, du 25 octobre 1985, 84-15.140 et 84-16.716 – https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007015716).
Dans la décision commentée la Cour de cassation ne prononce pas l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel pour se conformer à une loi nouvelle mais bel et bien pour s’aligner à sa nouvelle jurisprudence : « si c’est conformément à l’état du droit antérieur à l’arrêt du 7 mars 2024 que la cour d’appel en a déduit que la péremption était acquise, il y a lieu à annulation de l’arrêt attaqué en application de ce revirement de jurisprudence ».
Et si traditionnellement les annulations sont prononcées dans l’arrêt qui opère le revirement de jurisprudence lui-même, ici la Cour de cassation annule la décision des juges du fond sur le fondement d’un revirement qu’elle a opéré antérieurement, en 2024, mais postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de 2023.
Ainsi, la Cour de cassation a volontairement annuler l’arrêt d’appel sur le fondement de son propre revirement de jurisprudence, c’est-à-dire pour changement de droit ce qui place le « juge du droit » au centre de la construction de celui-ci.
Cette décision soulève donc une question fondamentale : si, comme le disait Montesquieu, « le juge est la bouche de la loi », ne se considère-t-il pas, ici, par cette « annulation » comme source du droit lui-même ?